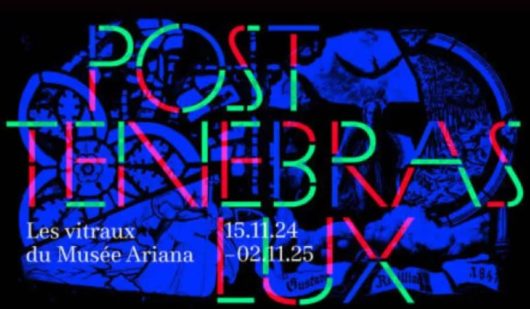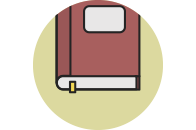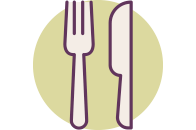La famille? C’est le lit et la table…
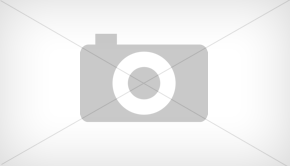
Lettre du mercredi 31 décembre 2014 - Source: Extrait de Echo Magazine, interview à Fabrice Hadjadj écrivain et philosophe
Dans votre nouveau livre sur la famille, vous écrivez qu’elle n’est pas d’abord le lieu où on s’aime et où on éduque les enfants. Voilà qui surprend…
Fabrice Hadjadj: – Dans un bon orphelinat aussi on s’efforce d’aimer les enfants, de les éduquer et de les respecter. Et peut-être mieux qu’en famille. Car en famille on s’engueule, on donne des dagues alors que l’institution dispose de pédagogues, de psychologues, de salariés du respect. Dans l’idéal, on pourrait imaginer qu’une entreprise spécialisée en éducation «s’occuperait» mieux des enfants que la famille traditionnelle.
Autrement dit, la compétence ne fonde pas la famille?
Le père n’est pas un expert (sinon il serait un ex-père) et la mère n’est pas thérapeute familiale. Certains défenseurs de la famille, y compris dans le monde catholique, croient la sauver en la présentant comme le lieu privilégié de l’amour, de l’éducation et du respect. Mais cette insistance sur les valeurs familiales dévalorise l’être de la famille réelle, car d’autres pourraient faire aussi bien ou mieux qu’elle. Aidons Huxley, l’auteur du Meilleur des mondes, disait déjà: «Je ne vois pas en quoi le fait de coucher avec une femme vous donne la compétence d’éduquer un enfant».
Dans ce cas, sur quoi se fonde la famille?
Sur le sexe. Aussi trivial que cela puisse paraître, la famille est le lieu où un homme et une femme ont des rapports sexuels dont jaillissent, par surabondance, des enfants. Dans une famille s’articulent la différence des sexes et la différence des générations, jusqu’au choc des cultures que symbolise la belle-mère. La filiation passe avant la qualité d’amour ou d’éducation qu’on peut donner ou recevoir.
Mais dire que «le principe de la famille est dans le sexe», n’est-ce pas courir à l’échec? Notre époque a voulu libérer la sexualité de l’influence de l’Etat, des Eglises et des intérêts familiaux. Aujourd’hui, le sexe est libéré, mais le couple et la famille n’ont jamais été aussi fragiles!
C’est que la liberté sexuelle dont vous parlez n’a pas grand-chose à voir avec le sexe et la famille. La sexualité est orientée vers l’enfantement alors que la libération sexuelle s’est faite justement contre le risque d’avoir des enfants: on veut bien jouer avec les parties génitales, mais pas pour la génération sexuée. D’une certaine façon, le projet moderne a voulu se libérer de l’ordre de la chair.
Mais le sexe ne se réduit pas à la reproduction…
Ce que je veux dire, c’est que la sexualité n’est pas d’abord le plaisir ou l’acte sexuel. C’est le fait que l’homme doit se tourner vers la femme pour devenir lui-même. Et réciproquement. La relation sexuelle nous pousse toujours au-delà de nous-mêmes. C’est notre société qui l’a réduite à un acte de consommation et de divertissement comme un autre. Vécue «à fond», comme le demande l’Eglise catholique, la sexualité est ouverture à la vie, à l’enfant. Mais, à la différence des bêtes, les hommes ont besoin d’une espérance pour enfanter. Personne ne fait des enfants pour la propagation de l’espèce. L’enfantement réclame une raison de vivre et c’est pourquoi la sexualité pousse à la spiritualité. Il faut une voix qui nous dise: «N’aie pas peur d’avoir des enfants, ne fais pas du sexe juste le moyen de fuir devant l’angoisse de la mort. Entre dans la vie!».
La crise de la natalité serait donc le signe d’un manque d’espérance?
On a perdu conscience que l’enfant n’est pas un projet casé dans son plan de vie quand toutes les conditions sont réunies. L’enfant est un événement! Je me souviens du moment où j’ai vu le visage de ma fille pour la première fois: ce fut l’inimaginable et l’inanticipable. L’enfant renouvelle notre vision du monde.
Mais pour cela, dites-vous, il faut se rappeler qu’on ne fabrique pas un enfant, mais qu’on l’aide à naître…
Le langage courant dit qu’on «fait des enfants», mais en sachant bien que le bébé n’est pas le résultat d’un processus de fabrication. Du moins on le savait: dans la procréation médicale assistée (PMA), le corps n’est plus considéré comme un donné, mais comme une base de données, un matériau utilisé pour fabriquer des enfants sur mesure. C’est la vision technocratique d’un corps qu’on peut modeler et améliorer à sa guise pour produire un surhomme. Un projet évidemment réservé aux riches: il y a une marchandisation des corps dont témoigne le marché des mères porteuses.
Pourquoi ne pas améliorer le corps humain si c’est possible?
Le danger que je dénonce est le dualisme corps-esprit: on veut se libérer toujours plus des contingences de la matière et de la nature. Le corps devient un accessoire extérieur, comme si l’homme était un ange piégé dans une chair périssable. De mon côté, je défends l’intrication du charnel et du spirituel: le corps est le socle de l’intelligence et il appelle la transcendance, une espérance. Alors que nier la chair est un rêve de perfection fondé sur le ressentiment, qui élimine le faible et le différent: avec la PMA, les handicapés sont éliminés dès l’éprouvette.
Vouloir le meilleur pour son enfant, n’est-ce pas naturel?
Plus on veut contrôler la réalité, plus on est inquiet et insatisfait. C’est le cas avec la multiplication des tests pendant la grossesse: les parents ne sont pas moins angoissés qu’autrefois. Le contrôle a remplacé la confiance. Et toute surprise potentielle, tout imprévu apparaît comme un risque qu’il faut éliminer par une meilleure programmation. Le contrôle sous-entend qu’il faut se méfier du don, de la vie.
La table familiale est «un objet technologique supérieur à la tablette électronique», dites-vous. Les nouvelles technologies reflètent ce refus de la chair que vous dénoncez?
Lisez-moi bien: je ne dis pas que la tablette est inutile ou nocive, mais technologiquement inférieure à la table. Si elle permet de trouver une bonne recette sur internet, tant mieux, elle est au service de la table. Hélas, dans trop de familles elle tend à se substituer à la table: chacun prend rapidement quelque chose dans le frigo pour retourner à son monde virtuel. La grande richesse de la table, qui semble un objet techniquement simple et pauvre, c’est la proximité physique: dans la famille, on ne se met pas autour de la table parce qu’on a les mêmes opinions (comme sur un blog ou dans un jeu en ligne) ou parce qu’on est de la même génération. Le père est assis avec le fils, le grand-père avec la belle-fille. La domination de la tablette affaiblit la présence de l’autre, elle fait éclater les liens de proximité alors que la table est le «métier à tisser» du tissu familial. Je regrette aussi la perte des arts de la table: la cuisine, la nappe et la décoration, l’art de passer les plats, de converser ou de chanter ensemble.
Au fond, vous rêvez d’une ferme où cuire votre pain au feu de bois en racontant des histoires aux enfants?
Je me sens proche en effet de certains mouvements écologiques ou de penseurs qui valorisent l’artisanat contre la surproduction industrielle. Dans nos contrées – et sans nier que la pauvreté existe -, on a souvent trop de choses pour mener une bonne vie, on croule sous l’accumulation de biens matériels. C’est le système qui veut cela alors que la vraie richesse, ce sont les personnes. C’est parce qu’on manque de présences autour de nous qu’on va multiplier les «amis» sur Facebook. Et même si nous avons des proches, nous ne savons pas les voir, être présents à leur présence.